Pourquoi la psychologie politique?
Il faudrait d’abord commencer par définir ce qu’est la psychologie politique.
Ce champ de la psychologie investigue les mécanismes et processus psychologiques qui sous-tendent les actions individuelles et collectives dans le domaine politique. Il englobe donc les thèmes de la gouvernance, du vote, de la psychologie des dirigeants, du langage politique, de la prise de décision, de la résolution de conflit, etc (Huddy et al. 2013).
C’est un domaine pluridisciplinaire qui emprunte à l’anthropologie, à l’économie, à la sociologie. Assez peu représentée en France, cette discipline est beaucoup plus présente dans les pays anglo-saxons.
Pourtant, il me paraît assez évident en ces temps de grèves massives, de défiance politique de la part des électeurs envers leurs dirigeants (nous reviendrons dans un autre article sur le choix peu judicieux du terme « dirigeants » lorsque l’on parle des hommes et femmes politiques qui nous gouvernent), la psychologie politique aurait fort à faire afin de participer à l’analyse de phénomènes sociaux et politiques comme: le mouvement des « Gilets Jaunes », le succès des populismes, l’amoindrissement de la démocratie, les mouvements de grève et leur (non-)résolution, la psychologie des élu.e.s, etc. Les sujets ne manquent pas. Bien que ces sujets soient amplement traités par les médias mainstream à travers différentes « analyses » d’experts politiques, la question de la psychologie des personnes concernées est rarement amenée en avant, ou alors au moyen d’analyse psychologique ne correspondant absolument pas aux standards de la psychologie contemporaine (n’entend-on pas régulièrement un homme ou une femme politique être taxé.e d’autisme – François Fillon qui ne l’est pas, Cédric Villani qui l’est – ou de schizophrénie, en faisant référence à de vieilles et obsolètes définitions de ces conditions?). La psychologie peut faire mieux que ça. De même, n’explique-t-on pas les comportements collectifs de manifestants, de grévistes, d’électeurs, qu’en invoquant de vagues notions sociologiques et démographiques sans s’intéresser aux facteurs réels qui font émerger ou disparaître ces comportements? Quel analyste politique peut aujourd’hui se targuer de connaître les raisons qui poussent des personnes à sacrifier des journées de salaires pour aller manifester ou se rassembler sur des rond-points? L’objectif de la psychologie politique n’est pas de prendre partie, mais plutôt de tenter d’expliquer les choix des uns et des autres. En ce sens, la psychologie comportementale trouve toute sa place.
État actuel de la psychologie comportementale
L’histoire de la psychologie comportementale pourrait se résumer en trois étapes:
- Depuis les années 1920 jusqu’au années 1970, la psychologie comportementale a été dominée par l’étude du conditionnement répondant et du conditionnement opérant (respectivement par Ivan Pavlov et B.F. Skinner). Tous les grands principes de la psychologie comportementale sont issus de ces travaux. J.B. Watson a également beaucoup œuvré pour le développement de cette branche de la psychologie, mais son travail a été beaucoup contesté par ses contemporains (et l’est encore de nos jours). Le point commun de ces différents auteurs étaient de considérer que l’environnement (social et physique) était le principal vecteur de l’apprentissage. En ce sens, la psychologie comportementale se veut pragmatique car son objectif est de rechercher dans l’environnement les « causes » du comportement. Cette démarche vient à contre-courant des autres traditions psychologiques favorisant l’introspection et l’appel à la personnalité, toutes deux cherchant les causes du comportement de la personne dans la personne elle-même.
L’intérêt de cette approche du comportement humain, notamment la version « skinnérienne » (connue sous le nom d' »analyse expérimentale du comportement ») est son ancrage dans le paradigme plus large et bien connu désormais de la « sélection par les conséquences », paradigme mis au jour notamment par la théorie de la sélection naturelle de Darwin. En effet, le comportement est notamment déterminé en grande partie par les conséquences passées qu’il a eu sur l’environnement. Ce dernier sélectionne le comportement selon son adaptabilité à un moment précis. Ce paradigme fait encore aujourd’hui l’objet d’une technologie connue sous le nom d’Applied Behavior Analysis (Analyse Appliquée du Comportement).

- Le deuxième vague de la psychologie comportementale est apparue grâce à la conjonction de deux facteurs: l’apparition des sciences informatiques et du micro-ordinateur dans les années 70/80 et le rejet de la première vague sous prétexte qu’elle ne prendrait pas assez en compte les pensées et les émotions de la personne dans les facteurs du comportement. Ainsi, la psychologie cognitivo-comportementale a vu le jour, et, en cherchant la cause du comportement dans les pensées et les émotions, s’est replacée dans une vision idéaliste et dualiste de la psychologie humaine en replaçant les causes du comportement à l’intérieur de la personne. La psychothérapie en TCC consiste alors désormais à modifier des schémas cognitifs dysfonctionnels, qui à leur tour modifieront les comportements.
De nos jours, c’est la branche de la psychologie comportementale la plus répandue, notamment grâce à la prolifération d’études portant sur « les biais cognitifs ». - La troisième vague, quant à elle, est beaucoup plus récente, et reprend la même direction que la première, en se replaçant philosophiquement dans les bases de la sélection par les conséquences chère à Darwin et Skinner, en y ajoutant la notion de sélection multi-niveau (sélection génétique, épigénétique, comportementale et culturelle). Elle porte le nom de « psychologie comportementale contextuelle » et son principal apport en regard de l’analyse du comportement skinnérienne est l’explication du langage et de la pensée symbolique avec le support de la Théorie des Cadres Relationnels (TCR ou RFT en anglais). Cette théorie a également fait l’objet d’une application thérapeutique sous le nom d’ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
Comme bien souvent, ces trois approches ont leurs adhérent-es et détracteurs, et elles se retrouvent régulièrement contestées par les un-es et les autres. Le point important à souligner ici, en ce qui nous concerne, est que les première et troisième vague sont fortement monistes et matérialistes: elles considèrent l’individu comme un et entier (ne séparant pas le corps et l’esprit – ou tout autre construit hypothétique), et cherchent les causes des comportements dans des variables observables et mesurables. Pourquoi est-ce si important? Parce que si les variables régissant les comportements individuels et collectifs sont observables et mesurables, elles sont également manipulables à toute fin utile. Par exemple, dans des comportements politiques.
Il y aurait beaucoup à écrire sur les concepts contemporains de la psychologie comportementale intéressants pour la psychologie politique (métacontingences, analyse comportementale des systèmes, analyse non-linéaire des contingences, etc.) mais ils feront l’objet d’un prochain article.
Naissance d’une psychologie comportementale politique
Comme nous l’avons vu, la psychologie comportementale contemporaine (sous la forme de l’Analyse Expérimentale du Comportement ou sous la forme de la Psychologie Comportementale Contextuelle) a beaucoup à apporter à une psychologie politique qui se voudrait scientifique. Le lecteur avisé se rendra vite compte que la psychologie politique, si elle se veut pluridisciplinaire, fait parfois appel à des approches et concepts idéalistes (des construits hypothétiques comme la personnalité) et dualistes (la psychologie cognitive, la psychanalyse). Nous pensons que la psychologie comportementale est plus à même d’apporter une analyse approfondie des phénomènes sociaux et politiques pour les raisons suivantes:
- son ancrage philosophie et épistémologique (moniste matérialiste) permet une analyse scientifique des phénomènes étudiés en les soumettant à l’expérimentation et en les incluant dans un paradigme plus large (évolution et sélectionnisme)
- la méthodologie de l’analyse expérimentale du comportement, notamment la prise de données et leur représentation, permet de se focaliser sur les évènements observables, mesurables et donc manipulables
- La psychologie du comportement dispose des outils conceptuels favorisant le changement individuel et culturel
- La psychologie comportementale, basée sur l’empirisme et l’action, est compatible avec certaines philosophies politiques basée sur la praxis (marxime, anarchisme)
- La psychologie comportementale ne se réduit pas à l’étude des individus mais peut s’intéresser aux comportements collectifs
En conclusion…
…nous pensons que le futur de la psychologie politique est comportemental. Il est impossible de détailler dans un article tel que celui-ci tous les concepts de la psychologie comportementale qui permettent, selon nous, une analyse et un contrôle expérimental des comportements politiques.
Cet article inaugural avait pour simple objectif de sensibiliser les lecteurs et lectrices à la psychologie comportementale contemporaine, peut-être en corrigeant certaines préconceptions erronées sur cette discipline.
Les prochains articles auront plutôt l’objectif de détailler ces concepts autour de thématiques actuelles, nationales ou internationales.
Références
Huddy, L., Sears, D. O., & Levy, J. S. (2013). Introduction. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199760107.013.0001
Roche, B., Barnes-Holmes, Y., Barnes-Holmes, D., Stewart, I., & O’Hora, D. (2002). Relational frame theory : A new paradigm for the analysis of social behavior. The Behavior Analyst, 25(1), 75‑91. https://doi.org/10.1007/BF03392046
Skinner, B.F. (1981). Selection by consequences. Science, New Series, Vol. 213, No. 4507. (Jul. 31, 1981), pp. 501-504
Ulman, J. D. (1991). Toward a Synthesis of Marx and Skinner. Behavior and Social Issues, 1(1), 57‑70. https://doi.org/10.5210/bsi.v1i1.188
Wilson, D. S., Hayes, S. C., Biglan, A., & Embry, D. D. (2014). Evolving the future : Toward a science of intentional change. Behavioral and Brain Sciences, 37(4), 395‑416. https://doi.org/10.1017/S0140525X13001593
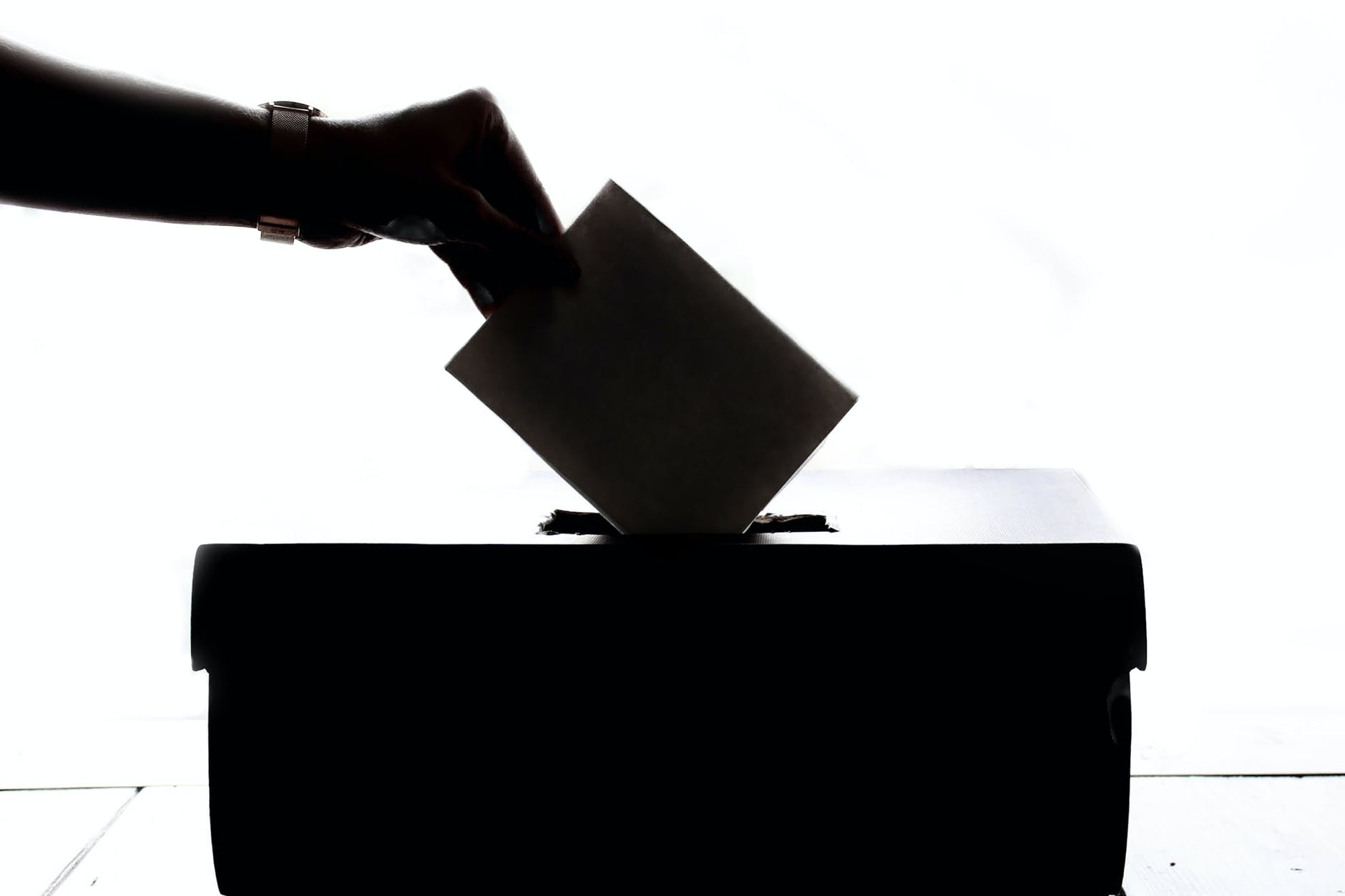
Bonjour et merci à vous pour cet article !
Cela fait déjà un moment que je cherche à articuler Politique et Behaviorisme Radical, votre blog tombe à point !
Peut être connaissez vous ce document de M. Esteve FREIXA i BAQUÉ:
http://esteve.freixa.pagesperso-orange.fr/behaviorisme_et_gauche_en_france.pdf
Au plaisir de lire la suite !
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre retour positif,
M. Freixa i Baqué a été mon professeur d’université et est encore aujourd’hui un ami cher, merci à vous de relayer son blog ici!
Bien à vous